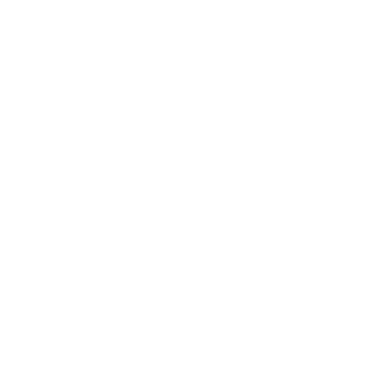Le Grand collisionneur de hadrons (LHC) vient de vivre un événement inédit : pour la toute première fois, il a fait entrer en collision des faisceaux de protons et d'ions d'oxygène. Le 29 juin a marqué en effet le début d’une période très spéciale pour le LHC, qui se prolongera jusqu’au 9 juillet : après deux jours de collisions proton-ion oxygène, le collisionneur connaîtra – autre première – deux jours de collisions oxygène-oxygène, puis un jour de collisions néon-néon, avec dans l’intervalle plusieurs jours consacrés au paramétrage et à la mise en service de la machine.
Les expériences du LHC attendent déjà avec impatience la moisson de nouvelles données que cette campagne permettra de récolter, en vue d’études dans un large éventail de domaines (rayons cosmiques, force forte et plasma quarks-gluons, notamment).
Ce n’est pas seulement le début d'une campagne stimulante ; c’est également l’aboutissement d'un processus long et minutieux, commencé dans le complexe d’accélérateurs à la mi-avril (et même en 2019 dans le cas des études de faisabilité initiales). Chaque machine a dû être spécialement configurée pour fonctionner avec des ions d’oxygène et de néon, qui sont produits dans le Linac 3 avant d'être injectés dans l’Anneau d’ions de basse énergie (LEIR), le Synchrotron à protons (PS), le Supersynchrotron à protons (SPS) (qui enverra également des faisceaux d'oxygène vers les expériences à cible fixe dans la zone Nord) et enfin le LHC.
« Le mode d’exploitation actuel, dans lequel un faisceau de protons entre en collision avec un faisceau d'ions oxygène, est le plus complexe, souligne Roderik Bruce, spécialiste des ions au LHC. En effet, le champ électromagnétique présent dans l'accélérateur affecte différemment les protons et les ions oxygène, en raison de leurs rapports charge/masse différents. En d'autres termes, sans corrections, les deux faisceaux entreraient en collision à des endroits différents à chaque tour. » Pour remédier à ce problème, les ingénieurs ajustent minutieusement la fréquence de rotation et l’impulsion de chaque faisceau afin que les collisions aient lieu au bon endroit, au cœur des quatre grandes expériences du LHC : ALICE, ATLAS, CMS et LHCb.
Cette campagne très spéciale ne concerne pas seulement ces quatre expériences. En effet, la semaine dernière, l'expérience LHCf, qui étudie les rayons cosmiques au moyen des particules aux petits angles créées lors des collisions, a installé le long de la ligne de faisceau du LHC, à 140 mètres du point de collision de l'expérience ATLAS, un détecteur, qu'elle utilisera pour l’exploitation proton-oxygène. Ce détecteur sera ensuite retiré et remplacé par un calorimètre, qui fournira des données supplémentaires lors des collisions oxygène-oxygène et néon-néon.
Cette campagne est également l’occasion de continuer à tester la technique de collimation à cristaux. Il s'agit d'une amélioration cruciale du système de collimation du LHC visant à atténuer le problème des halos de faisceaux d’ions (halos de particules qui s'écartent de l'orbite des faisceaux). Le système de collimation classique du LHC étant moins efficace avec des faisceaux d’ions, il est prévu, juste avant le début des exploitations oxygène-oxygène et néon-néon, d’insérer le long de la ligne de faisceau, à des fins d’essai, quelques collimateurs à cristaux.

Pour en savoir plus sur le programme de recherche des expériences LHC durant cette campagne inédite, lisez les articles suivants (en anglais) :
- Pour l’expérience ALICE : « Oxygen collisions at the LHC: Collapsing the nuclear wave function »
- Pour l’expérience ATLAS : « ATLAS takes a breath of oxygen »
- Pour l’expérience CMS : « First ever oxygen and neon LHC collisions are studied by CMS »
|
Des faisceaux pollués |