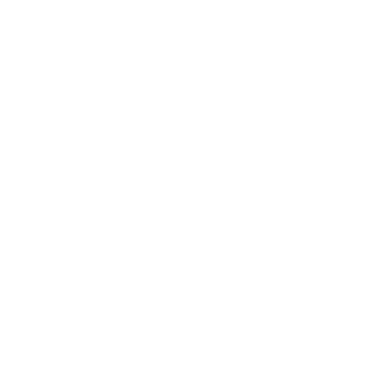Depuis qu’elles ont annoncé la découverte du boson de Higgs en 2012, les expériences CMS et ATLAS continuent à mesurer sa masse et ses interactions avec d’autres particules avec une précision toujours plus grande. Les scientifiques s’intéressent désormais à l’interaction du boson de Higgs avec lui-même, qui pourrait apporter des éléments d’explication sur la stabilité de l’Univers. Pour cela, les scientifiques recherchent un phénomène beaucoup plus rare que la production d’un boson de Higgs : la production de paires de bosons de Higgs, connues sous le nom de di-Higgs. Dans une nouvelle étude s’appuyant sur les données issues de collisions proton-proton de haute énergie collectées lors de la deuxième période d’exploitation du Grand collisionneur de hadrons (LHC), l’expérience CMS a publié ses recherches les plus récentes concernant la production de di-Higgs et établi des limites concernant son taux de production.
Il existe deux principaux modes de production de paires de bosons de Higgs. Le premier est la fusion gluon-gluon : des gluons – particules présentes à l’intérieur des protons en collision – interagissent pour produire des bosons de Higgs. Ce processus permet d’étudier l’interaction entre un boson de Higgs à un état dit intermédiaire et deux bosons de Higgs à l’état final. Le deuxième mode fait intervenir des quarks, particules également présentes à l’intérieur des protons en collision, qui émettent deux bosons vecteurs. Ces bosons vecteurs interagissent ensuite pour former des bosons de Higgs, ce qui permet d’étudier les interactions entre deux bosons de Higgs et deux bosons vecteurs.
Dans leur analyse la plus récente, les scientifiques de CMS ont recherché différents modes de désintégration du di-Higgs. Ces états finaux résultaient de la désintégration de paires de bosons de Higgs en quarks b, bosons W, leptons tau et photons. En combinant ces recherches et en analysant toutes les données simultanément à l’aide de techniques sophistiquées – notamment des arbres de décision optimisés et des réseaux neuronaux profonds – la collaboration a réussi à extraire une quantité inédite d’informations.
L’étude a permis aux scientifiques d’établir des limites supérieures concernant les taux de production de paires de bosons de Higgs, avec un degré de confiance de 95 %. Les limites mesurées sont actuellement 3,5 fois supérieures aux prédictions du Modèle standard pour la production totale de di-Higgs, et 79 fois supérieures aux prédictions du Modèle standard pour la production par le biais d’une fusion de bosons vecteurs.
Alors que la prise de données de la troisième période d’exploitation est en cours, l’expérience CMS a déjà doublé la quantité de données collectées et l’analyse de ces données par les scientifiques de l’expérience est en cours. Le futur LHC à haute luminosité (HL-LHC), qui devrait entrer en service en 2030, ouvre des perspectives particulièrement intéressantes s’agissant de la mesure de l’interaction du boson de Higgs avec lui-même. Le HL-LHC fournira à l’expérience la luminosité la plus élevée jamais atteinte dans un collisionneur. Compte tenu des projections concernant la luminosité et des incertitudes systématiques, les scientifiques estiment qu’ils pourraient commencer à observer les premiers indices probants de la production de di-Higgs lorsqu’ils disposeront d’environ la moitié des données du HL-LHC. La collaboration attend avec intérêt de pouvoir étudier plus avant ce phénomène rare et passionnant.
Pour en savoir plus :